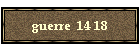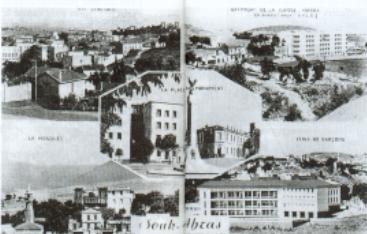la génealogie
une passion conduisant qui la pratique aux portes de l 'aventure .tenant à la fois de l 'enquête policière à chacun de faire œuvre d 'historien et de réaliser le vieux rêve de l 'homme en généalogie : si les dictionnaires définissent la généalogie comme la science ayant pour objet la recherche des filiations 'elle est,en fait, beaucoup plus que cela .la généalogie est avant tout remontant le fil des siècles sans la moindre machine et de la collection ,elle propose un loisir tant ludique que culturel ,loisir individuel et familiale varié et peu coûteux, qui permet à chacun de faire œuvre d 'historien et de réaliser le vieux rêve de l 'homme en remontant le fil des siècles sans la moindre machine ( Jean -louis Beaucarnot )
Pour l 'Afrique du nord :pour les documents d 'état civil de moins de 100 ans .vous devez vous adresser au ministère des affaires étrangères service central de l 'état civil 44941 Nantes cedex 9
site web
pour les archives de plus de 100 ans faire ses recherches au CAOM 29 chemin du moulin Detesta 13090 Aix en Provence :on y trouve l 'état civil ;demande de concessions de terres, une documentation sur la naissance des villages et villes d 'Algérie ;des dossiers militaires ;les SAS ; les journaux de l 'époque et beaucoup d 'autre choses.....
site web:
http://caom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ecfa/
la revue du GAMT Première association généalogique de l 'Afrique du nord :revue trimestrielle comportant une cinquantaine de pages .vous y trouverez un éditorial -articles sur la vie des villages ,souvenirs, curiosités ,l 'émigration, les concessions 'administration ,les monuments etc.. les recherches en Espagne ,Algérie Italie ,Malte ,la vie des antennes ;la bibliothèque,courrier des membres :question et réponses ....
site Web : http://www.genealogie-gamt.org
ces trois sites sont une bonne base de recherches sachant que notre état civil se trouve à Nantes ou au CAOM (Aix en Provence ) pour les personnes nées en Afrique du nord ; mais une bonne partie se trouve encore en ALGERIE (.certaines APC délivrent des actes d 'état civil ) l 'état français est toujours en négociation avec l 'état algérien pour obtenir ces actes restés en Algérie.....
CHOFFARD GILBERT et Michèle ARROUE nous présentent leur généalogie (leur famille ont été propriétaires de la gazouse )
Généalogie Choffard Meuniere -
--
Généalogie Arroue
Recherche par Philippe Vanneau ( identification d 'une photo )à trouver
sur la page gazouze
Je m'appelle Philippe VANNEAU, je suis né à Alger en 1964, mon père, mon grand-père et mon arrière grand-père sont nés à Souk Ahras.
Ma grand-mère (Marinette VANNEAU née MANNONI) avec mon père Guy, peut-être une cousine ARROUE, Jeanne VANNEAU (belle-sœur de ma grand-mère), peut-être une autre cousine ARROUE, la petite fille dans les bras étant la fille de Jeanne VANNEAU.
Peut-être que par votre intermédiaire je pourrais mettre un nom sur les deux visages pour lesquels je ne suis pas sur et peut-être entrer en contacte avec des descendants ARROUE car mon arrière grand-père, Louis VANNEAU était marié avec Virginie ARROUE (donc mon arrière grand-mère), fille de Etienne ARROUE qui venait de Ance dans les Basses Pyrénées.
En effet, sur votre site j'ai vu qu'il y avait des ARROUE qui témoignaient, des descendants de Pierre ARROUE le frère d'Etienne, il me semble.
Deux familles alsacienne en Algérie
Deux familles AMIA ALSACIENNE vont quitter THANN après la guerre de 1871 pour rester français ils vont s 'établir en ALGERIE dans le département de Constantine Souk Ahras et AIN SEYNOUR une famille et un célibataire
famille
AMIA Nicolas 29/03/1827 à THANN (parents père Nicolas et de Martin Marie Anastase ) et épouse Ringenbach Catherine née 14/03/1833 à Storkensohn vallée de Thann ( parents père François ;mère Grunnewald Marie Anne ) et leurs 6 enfants 3 filles 3 garçons
Marie Eugénie née le13/07/1865 à THANN ( mariée à VINCENT Joseph )
Eugène né le7/09/ 1866 à THANN (marié à BONNIER Julie )
Joséphine née le 13/07/1868 à THANN mariée à JAMET Jean)
JOSEPH né le 04/04/1871 à THANN ( marié à GONTRON Agnès )
EMILE Paul Nicolas né le 08/09/1872 à Clermont-Ferrand Puy de Dôme( marié à Girardon Anne )
Marie Emilie né le 7/12 1873 à Clermont- Ferrand Puy de Dôme ( mariée à CAUSSADE Jean MARIE)
Nicolas Amia décédera à Ain Seynour le 15/03/1900
Ringenbach Catherine décédera à AIN Seynour le 07/01/1911
(les alsaciens sont devenus Prussiens après la défaite de1871 ; arrivés en Algérie ,ils devront obtenir de nouveau la nationalité française ....... );
Nicolas AMIA a fait la guerre contre la Prusse après la défaite il se réfugie avec sa famille à Clermont Ferrand , (Puy de dôme) il sera aubergiste - 2 nouveaux enfants Emilie et Marie Emilie naitront à Clermont Ferrand - ensuite partira avec sa famille en ALGERIE Française
Célibataire
un célibataire qui va se marier en ALGERIE (Souk Ahras )
AMIA léon charles né le 22 avril 1868 à THANN Haut Rhin (parents père Thiébaud mère Flieg Marie Anne )
profession dessinateur à Paris rue du renard dans le 18 arrondissement
engagé volontaire pour 5 ans du 9 septembre 1886 à la sous intendance militaire pour le 1 reg étranger part en compagne en Afrique Algérie du 23 septembre 1886 au au 22 juin 1890 passé dans la réserve le 9 septembre 1891(va redevenir français par décret du 31 mai 1890 ------)
Accompli une période au 3 régiment de zouaves du 21 mai au 3 juin 1900
passé dans la réserve territoriale le 1 aout 1907 ; libéré du service militaire le 9 septembre 1911
Va travailler en 1892 au chemin fer algérien en 1892 au matériel sur la ligne Bône Guelma; va résider à SOUK AHRAS
Va se marier à Souk Ahras (Algérie française ) avec mademoiselle Freches MARIE née le 14/08/1870 ;ils auront 2 enfants René Thiebault né le 23/07/1893 à SOUK AHRAS qui sera tué aux Dardanelles Turquie guerre14-18 mort pour la France en héros (une rue portera à Constantine le nom de Sergent Amia )
Lucien romain né le 02/03/1895 à Constantine va exercer le métier d 'entrepreneur de transport marié à MOLLES Renée Marie ils auront deux filles Lucette et Renée Paulette........
Amia LEON CHARLES décédera le 23 12 1941 à Constantine Algérie
Fréches Marie décédera le 01/02/1953 à Constantine ALGERIE
|
|
|
|
renseignements donnés sur Jules Alphonse JULES AGRE
bonjour Monsieur,
Par hasard, au détour de la recherche de mes origines paternelles, je viens de
tomber sur votre site.
J'ai découvert avant cela, ces éléments qui pourront peut être vous aider aussi
:
- mon arrière grand père paternel, Jules-Alphonse AGRE, né à Arras (f) le 11 mai
1815, et décédé à AÏN SEYNOUR, le 27 Janvier 1885.
Il avait été déporté ( comme 13.000 autres éléments considérés comme dangereux à
la suite de la révolution de
fév.1848 ).
Il a quitté Paris le 2 novembre 1848, et a embarqué sur la corvette Le Labrador,
le 20 novembre 1848, pour arriver enfin à Mers-el-Kébir.
Il est repris sur la liste de la colonie agricole du 12 janvier 1849, destinés à
peupler SAINT LOUIS, le village de Sidi Ali.
Ce convoi est le 7ème (il y en aura 17 au total dont 1 en provenance de Lyon ).
Il comporte 831 personnes dont 22 de moins de 2 ans/
Jules-Alphonse est accompagné de sa première épouse, Pauline-Françoise DESTREE,
alors âgée de 28 ans, ainsi que de leur fils Jules, âgé de 6 ans.
Je retrouve ensuite mon arrière-grand-père JAA à paris, marié à Marie Laulangea.
Il a alors 51 ans, et elle 27. Ils déclarent un fils, Louis, le 3 septembre
1866, mon grand père paternel.
Par un autre canal je trouve qu'ils ont aussi une fille : Marie, née le 30
juillet 1861, à parie, et décédée à .....AHRAS en 1886. Je découvre aussi
qu'elle s'est mariée à SOUK AHRAS avec un mr edouard MESNIL.
De tout cela il ressort que je ne retrouve trace nulle part, de Jules AGRE né à
Paris probablement vers 1842,
pas plus que de sa mère Pauline-françoise DESTREE épouse AGRE arrivée à SIDI ALI
en 1849.
Que sont-ils devenus ?
bien cordialement
françoise welcoimme-agré
01370 Courmangoux=
LES
EMIGRES 'VOLONTAIRES' DE 1848
Après les événements de Février et Juin 1848
et
la fermeture des ateliers nationaux et suite à la répression féroce de
Cavaignac, plus de 15000 ouvriers Parisiens et autres, furent vivement incités à
émigrer vers l'Algérie. On leur promettait monts et merveilles, pourvu qu'ils
débarrassent le plancher.
histoire et généalogie de 3 familles SAVOYARDES (les ) Vincent (de Voglans --El Ouricia
Souk Ahras Ain Seynour)
(joseph et Noëlle BUffet ;Catelin et claudine buffet ;André et Dupuis Beatris parties de VOGLANS vers 1857 pour travailler comme cultivateur dans une société genevoise suisse dans la région de Sétif (EL OURICIA )Algérie
-VINCENT Joseph né le 25/09/1830 fils de Vincent Charles et de Doner louise marié à Buffet Noëlle LE 17 décembre 1833,un enfant PIERRE né le 30/03/1856 à Voglans (à leur départ )
-VINCENT Catelin dit Tavian né le03/03/1826 à Voglans fils de Vincent joseph et de MORAT Françoise Sébastienne marié à BUFFET Claudine née le 25/06/1837......un enfant Catherine ( à leur départ )
-Vincent André né le 02/04/1809 à Voglans fils de Vincent joseph et de Morat Françoise Sébastienne marié à Dupuis Beatrice née vers 1828 .....Sans enfant (à leur départ)
(on remarque que VINCENT Catelin et Vincent André sont deux frères . Buffet Noëlle et buffet Claudine sont 2 sœurs )
VINCENT Catelin est mon arrière grand-père (notre pour Josette ;Paule ;Geneviève ;Christiane )
APERCU DE L 'ARBRE de ( Catelin et André Vincent )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fratrie
![]()
![]() Claudine
VINCENT 1804-1845 Mariée le 17 février 1824
(mardi), Voglans, 73420, Savoie, Rhône-Alpes, France, avec Catherin
(NOIRAY dit PERRIER) NOIRAY 1803-1841
Claudine
VINCENT 1804-1845 Mariée le 17 février 1824
(mardi), Voglans, 73420, Savoie, Rhône-Alpes, France, avec Catherin
(NOIRAY dit PERRIER) NOIRAY 1803-1841
![]()
![]() Jeanne
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1806-
Jeanne
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1806-
![]()
![]() André
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT né
le 02/04/1809 marié le 15/02/1858 à Voglans SAVOIE mariage avec Beatrix DUPUIS
André
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT né
le 02/04/1809 marié le 15/02/1858 à Voglans SAVOIE mariage avec Beatrix DUPUIS
![]()
![]() Émilie
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1811-
Émilie
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1811-
![]()
![]() Martin
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1815-1835
Martin
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1815-1835
![]()
![]() Françoise
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1818-1875 Mariée le 7 février 1842
(lundi), Voglans, 73420, Savoie, Rhône-Alpes, France, avec Honoré
(LOVET dit CAPITAN) LOVET 1813-1868
Françoise
(VINCENT dit TAVIAN) VINCENT 1818-1875 Mariée le 7 février 1842
(lundi), Voglans, 73420, Savoie, Rhône-Alpes, France, avec Honoré
(LOVET dit CAPITAN) LOVET 1813-1868
![]()
![]() Catelin
VINCENT né 03/03/ 1826-1871 Marié
24/02/1897, VOGLANS, 73000, Savoie, Rhône-Alpes, France, mariage avec Claudine
BUFFET 1833-1914
Catelin
VINCENT né 03/03/ 1826-1871 Marié
24/02/1897, VOGLANS, 73000, Savoie, Rhône-Alpes, France, mariage avec Claudine
BUFFET 1833-1914
Selon Geneanet : "On rencontre ce nom dans la région Rhônes-Alpes. Il s'agit très certainement d'une francisation de l'italien Taviani, hypocoristique de Ottaviani (lui-même formé sur le nom de baptême Ottavio = Octave), ou même d'un nom italien non modifié : le patronyme Tavian est en effet présent en Vénétie et dans le Frioul."
le patois savoyard est proche des dialectes italiens ; on peut donc penser que Tavian vient du prénom Octavien , père de joseph Vincent ; comme à Voglans il y a de très nombreux homonymes portant le patronyme Vincent, il y a souvent ajout d'un surnom en rapport avec un parent proche, et ensuite le surnom se propage ou non aux générations suivantes.
Cordialement
Ghislaine Pastorino
l
Les trois familles VINCENT vont partir travailler pour la compagnie Genevoise, comme ouvrier agricole ;on peut évaluer leur départ après 1857 ;on retrouve leur trace dans le région de Sétif, El Ouricia ,Mahouan
des enfants sont nés dans les trois couples ;(on peut penser que le couple joseph vincent et buffet Noëlle sont partis plus tard que 1857 )
**Pour Vincent André et Dupuis Beatris un enfant Catelin né le04/06/1861 à El Ouricia
**Pour Catelin et Claudine Buffet ;--Catherine née à Voglans le 20/11/1857--jeannette née le 07/11/1859 à el ouricia--joseph née le 06/02/1862 à El Ouricia (notre gpére) --Marie Joséphine née le 10/03/1868 à Souk -Ahras--francoise né le 26/08/1870 à Souk- Ahras --(4 filles et un garçon)
** Pour joseph et Beatris Dupuis 2 enfants --pierre né le 30/03/1856 à Voglans --Claudine née le 28/04/1861 à El Ouricia
TOUS ces savoyards vont être exploités par la société suisse qui préfère employer des ouvriers kabyle à moindre prix .....
Après une plainte à napoléon 3 en visite en Algérie ;ils décident de quitter El Ouricia après 1867 pour SOUK -AHRAS ;ou Pierre ,Catelin et André vont être victime de l 'insurrection kabyle
Les malheureux colons ont enduré bien d'autres épreuves dont la relation dépasserait largement les limites d'un simple article. II suffit de rappeler quelques-uns de ces événements
-
en 1867, année de sauterelles et de sécheresse : la campagne est devenue un
désert. Les Arabes l'appellent " l'année noire ". Les chemins sont jalonnés de
cadavres par la famine qui sévit. La culture est délaissée et l'aspect de ruine
règne partout ;
- l'hiver 1867-1868 arrive sans paille ni fourrage. On recherche du " diss "
pour essayer de nourrir les mulets qui dévorent les crèches et les râteliers.
Les vaches sont vendues à vil prix à des spéculateurs qui viennent de la région
de Bône. Pour poursuivre, il faut emprunter de l'argent à des usuriers locaux au
taux minimum de 15 % et acheter des semences quatre fois leur prix ;
- en 1871, c'est l'insurrection de Mokrahi qui suit la chute de l'Empire. Le
pillage et l'incendie réduisent à néant les efforts. Les meules de paille et de
fourrage sont en cendres, les magasins vidés, les caves et les maisons pillées,
car il est impossible de mettre à l'abri des insurgés les denrées lourdes et
impossibles à transporter dans ces temps troublés où l'ordre de partir se
réfugier derrière les remparts de Sétif vient du commandant de la place. II faut
à nouveau reconstruire, entreprendre encore sans se laisser décourager... pour
certains seulement.
- en 1875 sévit une épidémie de charbon qui décime les troupeaux.
- en 1887, année de sauterelles à marquer d'une pierre noire, les récoltes sont
dévorées, la vigne rongée, la luzerne " broutée " jusqu'à la racine.
Premières réalisations de la Compagnie genevoise. - Le premier village construit est Aïn Arnat, à 9 km de Sétif sur la route de Bordj Bou Arréridj, dans le voisinage de ruines romaines assez importantes qui semblaient recommander cet emplacement à l'attention des colonisateurs. Les maisons ont été bâties en moins de six mois alors que le décret accordait un délai de deux ans. Le lotissement des parcelles est loin d'être achevé. En effet, le lot de chaque colon prévoit 20 hectares de terres répartis en 20 ares de jardins, 1 hectare 80 ares en prairies naturelles, 6 hectares de champs de première qualité et 12 hectares de champs de deuxième qualité. Le 31 octobre 1853, les 86 premiers immigrants accompagnés d'un inspecteur de la compagnie, M. Gossen, arrivent à Aïn Arnat. Ils ont quitté Genève les 17 et 18 octobre. Ils sont tous vaudois.
La compagnie comprend dans ce nombre neuf employés destinés à son domaine d'El Bez dont 679 hectares ont été choisis par elle aux portes même de Sétif, sur l'emplacement où l'administration militaire avait prévu d'élever un haras. Les arrivées se succéderont alors les 8 novembre, 23 novembre 1853, 7 janvier, 29 janvier, 14 février puis cinq autres jusqu'au 28 mars 1854. Le 13 juin 1854, la compagnie déclarera :
-
Aïn Arnat : 388 âmes ;
- Bouhira (3) : 6 âmes ;
- ouvriers: 187 âmes.
La compagnie a en effet entrepris la construction de quatre autres villages: Bouhira, Aïn Messaoud, Mahouan et El Ouricia.
A ce point il est intéressant de savoir quelles conditions la compagnie avait mise pour devenir colon. Elle a le choix des colons et le droit de refuser ceux sur lesquels elle n'aurait pas eu de renseignements suffisants ou de mauvais renseignements. Le postulant colon doit verser 1 000 F comme acompte avec possibilité de se libérer des 1 500 F restant par paiements annuels de 100 F avec intérêts de 5 % l'an. D'autre part, le décret prévoit que ne peuvent être acceptés que des individus majeurs pouvant verser à Genève, avant leur départ, 2 000 F qui leur seront restitués par le gouvernement français entre les mains duquel ils auront été déposés, à raison de : 1 .000 F à leur arrivée à Sétif, 500 F six mois après et 500 F à la fin de la première année.
La compagnie, profitant du fait que le décret ne prévoit pas que les acquéreurs doivent occuper leurs maisons dans l'un des villages, tourne la difficulté en prévoyant que l'acquéreur peut envoyer un représentant, un métayer ou un fermier. Bien plus elle prévoit qu'une commune peut acquérir un lot dans l'un des villages de Sétif. Cette mesure, dit-elle, présente un très grand avantage pour les communes en leur permettant de procurer ainsi une existence aisée aux familles pauvres, mais laborieuses, dont elles sont chargées, tout en faisant en réalité un sacrifice bien moins considérable que celui qui est représenté par des secours annuels. Ainsi donc, pour ces communes (suisses, bien entendu) l'affaire est plus que rentable : elles se séparent de ceux auxquels elles versent des secours, et font une opération lucrative en diminuant leurs dépenses et en accroissant leurs ressources.
Ainsi, pour Aïn Amat, sur les 50 lots, 11 sont à un seul propriétaire, 6 sont à un autre et 7 sont colons avec hypothèques au bénéfice de tiers. Dans certains lots on verra, dans des maisons de 3 pièces, s'entasser 11, 15, 17, et même 19 personnes.
Au train où ont été les travaux de construction d'Aïn Arnat, l'Administration n'a pu suivre et la voirie n'est pas achevée ; l'école, le presbytère ne sont pas construits. Les plans du temple protestant ne sont pas arrêtés
L'odyssée des premiers colons d'Aïn Arnat. - Henry Dunant, le futur fondateur de la Croix Rouge, membre de l'aristocratie genevoise et qui était en apprentissage de banque chez les financiers Lullin et Sautter, part pour l'Algérie le 1er septembre 1853 et rentre à Genève le 28 octobre 1853, avant donc l'arrivée du premier convoi.
Il écrit un article dans le Journal de Genève du 3 novembre 1853 où il dépeint à ses lecteurs un pays prospère, sain, fertile, où règne la sécurité, avec une main-d'œuvre arabe bon marché et les autorités françaises attentives au bien-être des colons. II écrit un nouvel article dans le Journal de Genève du 22 janvier 1854 où il reprend les termes d'une lettre que vient de lui adresser " un jeune commerçant wurtembergeois, M. Henry Nick, établi à Sétif " et dont il a fait la connaissance dans cette ville. Tout est idyllique à Aïn Arnat, tant dans les activités que dans l'existence des premiers colons.
Ceux-ci, pour s'en tenir au premier voyage, sont partis de Genève les 17 et 18 octobre 1853. Avant leur départ, ils ont demandé la célébration d'un culte et c'est le pasteur Barde qui a officié. Certains sont déjà partis à pied pour Lyon. Le convoi s'ébranle en diligences et chariots. A Lyon c'est l'embarquement sur le Rhône que l'on descend jusqu'à Avignon et l'on reprend, jusqu'à Marseille, des chariots et des diligences. A Marseille, certains vont loger à l'auberge Benet, d'autres vont à l'hôtel, d'autres dormant à la belle étoile. Chacun agit selon ses moyens, car le voyage n'est gratuit que pour la traversée de la mer, l'Etat français le prenant à sa charge. Le dimanche 23 octobre on quitte Marseille. Dès la sortie du port la mer est fort agitée et elle va en se gonflant. Les domestiques sont dans les cales et les autres passagers sont répartis dans des cabines, hommes d'un côté, femmes et enfants de l'autre. Beaucoup sont malades, il faut s'en occuper, les laver, les aider. Le bateau se dirige vers la Corse pour y trouver refuge en cas de besoin tant la tempête fait rage. Mais, la mer se calmant, on se dirige de nouveau vers l'Afrique.
Le mardi 25 octobre, par un beau temps, clair, lumineux on voit les côtes se profiler à l'horizon et l'on débarque à Stora, près de Philippeville. Le débarquement se fait au milieu d'un grand mouvement. On est accueilli par les autorités, par le pasteur de Philippeville, M. Curie et par le directeur de la compagnie à Sétif, M. le baron Aymon de Gingins La Sarraz. Tant bien que mal on essaie de retrouver et de regrouper ses affaires, ses caisses, les enfants, les hardes ; mais l'armée garantit que le nécessaire sera fait pour tout récupérer. On va à l'" Asile " où il n'y a que 30 lits et où des paillasses doivent être installées.
Le mercredi 26, au matin, le convoi s'organise : ce sont des chariots bâchés de l'armée, tirés par des mulets. On s'y installe avec des paillasses " couvertes " et quelques bagages. Les gros colis, paquets, malles et autres sont arrangés sur des prolonges d'artillerie. Leur transport sera sans doute plus long. Des soldats sont là pour guider les attelages et aussi pour aider. II y a enfin une escorte. On passe la nuit à El Arrouch, au poste militaire où des soupes chaudes sont servies avec du gros pain, de la bière et de l'eau.
Le 27 octobre, une nouvelle étape conduit à Constantine. Le campement y est plus important. Et le lendemain on est impressionné par l'importance des gorges et leur profondeur, car les casernes n'en sont pas loin. Les uns couchent sous des tentes, d'autres dans une salle de la caserne, d'autres enfin préfèrent rester dans les chariots pour mieux veiller à leurs affaires ou à celles de leurs maîtres. On a déjà senti la différence de température avec celle du littoral mais il paraît que là où l'on va ce sera encore plus haut : près de 1 100 mètres d'altitude !
Le vendredi 28, on part vers Mila. Le voyage est pénible ; il est même souvent impressionnant car on est dans un relief accidenté avec des sentes qui longent des ravins ; en certains endroits les forêts sont profondes, sombres, mystérieuses. C'est parfois angoissant lorsqu'on entend le rugissement d'un lion, des " rires " de hyènes, des hurlements de chacals et autres animaux. Le froid se fait vif à certaines hauteurs, le vent est parfois violent et on s'abrite comme on peut sous les bâches que des ondées traversent malgré tout. On repart de Mila le samedi 29 pour Djemila. On y voit quelques ruines romaines, surtout celles d'un grand arc qui avait paraît-il, été fort remarqué par le duc d'Orléans. Après une nuit à Djemila, on passe devant le petit cimetière où sont enterrés des militaires français qui ont été tués dans la nuit du 15 au 16 décembre 1838. Ils faisaient partie du 3e Chasseurs d'Afrique. (Tout cela ce sont nos militaires qui nous le racontent.) Nous partons donc pour Sétif. On aperçoit des masses imposantes de montagnes : les Babor !
On arrive à Sétif le dimanche soir, en entrant dans la citadelle par la porte de Djemila (5).
Le 31 octobre 1853, le grand jour est arrivé. On quitte Sétif en sortant de la citadelle par la porte Napoléon. On longe quelques maisons dont l'hôtel du Trésor et de la Poste, puis on tourne à droite. On passe devant une placette que borde l'église et l'on débouche sur une grande place où il y a une grande fontaine qui semble donner beaucoup d'eau. Sur la droite il y a un bâtiment à arcades qui est le bureau des Affaires indigènes. Sur la gauche s'élève une belle mosquée que le Génie a construite il y a seulement dix ans... Ils nous en donnent des informations nos braves militaires ! On franchit les remparts par la porte d'Alger, à double voûte. La " route " est bordée d'arbres plantés récemment et, sur la droite il y a les " allées d'Orléans ". II y a encore de nombreuses ruines romaines bien qu'on en ait, paraît-il, beaucoup utilisé pour construire la ville, la citadelle, les remparts. Après, la végétation est peu abondante. Les arbres sont bien maigrichons. On longe pourtant quelques jardins cultivés. Ce qui frappe c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'arbres, rien vraiment pour arrêter la vue. On descend vers un cours d'eau, l'Oued Bou Sellam, que l'on franchit sur une passerelle construite par le Génie. La route remonte alors et peu après aboutit à une ferme avec un bâtiment et des hangars, c'est El Bez, la ferme de la compagnie, où s'arrêtent les ouvriers. On se dit au revoir et le convoi reprend son chemin, continuant à grimper la côte qui est assez raide et tortueuse, jusqu'à une hauteur d'où l'on peut voir le panorama de la grande plaine qui s'étend au loin. Au nord il y a les montagnes du Mégris et de I'Anini, au sud, la plaine est barrée par le Bou Thaleb et d'autres chaînes du Hodna. Face au convoi, à l'ouest, on distingue les monts de Medjana.
Les nuages ont fui. Le ciel est bleu, intensément, avec un soleil radieux qui ne réchauffe pourtant pas l'air bien frais mais si pur.
Enfin, après un trajet que l'attente rend plus long, tout droit à travers la plaine, c'est " le village " !
L 'Installation des colons à Aïn Arnat. - Les maisons sont basses, petites, rangées le long de sentiers cahoteux, inégaux, boueux par endroits ; la délimitation des " jardins " est , pour certaines, faite de barrières en bois, qui, sans doute, ne dureront pas bien longtemps ; des maisons sont encore inachevées : l'aspect de chantier est partout. Un poteau près de l'entrée porte un carton avec un numéro qui permet de trouver son lot. II va donc falloir savoir où l'on est. Comme on est arrivé par l'est, on se dirige vers une grande place où une fontaine orientée vers le nord, coule doucement. Une autre au sud est plus abondante. Les fourgons se rangent. Le directeur est là pour aider à trouver des lots. On est bien secondé par les militaires qu'on a appris à bien connaître et auxquels on s'est attaché depuis le début du voyage. Ils déchargent, ils transportent aussi. Mais les bagages qui sont sur les prolonges n'arriveront que plus tard. On entre dans les maisons par une porte qui ouvre sur une pièce où est une grande cheminée. De chaque côté, une porte communique avec une pièce éclairée sur le devant par une fenêtre et sur l'arrière par un vasistas. Au fond de la pièce centrale, une porte donne sur un grand terrain où l'on voit, au fond, quelques planches montées à la hâte pour clôturer le " lieu d'aisances ". Du bois a été rangé près de la maison : on pourra ainsi se réchauffer et chasser cette humidité qui prend à la gorge et qui transperce. Le toit est apparent, il n'y a pas de plafond et il est curieux qu'aucune fenêtre n'ait été prévue dans la pièce centrale. La superficie totale est de 60 mètres carrés ! Pour ce soir, il faut s'occuper, avec les militaires installés au village, pour obtenir des paillasses et de la nourriture. On se renseigne aussi pour savoir où il y aura des ouvriers pour fabriquer le mobilier de première nécessité.
Les convois qui arriveront ensuite seront mieux lotis, sans doute, car il y aura des compatriotes pour les accueillir, qui auront déjà résolu bien des problèmes. Mais pour tous il faudra force, courage et volonté. Malgré la fatigue, on se réunit sur cette grande place, sous la voûte du ciel qui sera le nôtre désormais, pour prier Dieu et Le remercier de nous avoir protégés tout au long de ce voyage.
Les contacts avec les Arabes se font bien vite. Ils commencent par les enfants qui arrivent d'une mechta installée plus au nord, de l'autre côté de la route. Le difficile est de se comprendre. Mais avec force gestes on y parvient quand même. C'est ainsi qu'on apprend qu'ils appellent tous ceux qui ne sont pas de leur race des "Roumis " - les Romains ont-ils donc ainsi marqué ce pays pour qu'on y fasse encore référence ? - Mais nous, les colons, on nous appelle des " Souissi " (c'est ainsi du reste que seront toujours appelés les protestants).
Pour Noël on se réunit. II n'y a pas encore de pasteur et c'est M. Ducraux, le régent (instituteur) qui lit un passage de la Bible, celui de la Nativité bien sûr, puis la liturgie et un commentaire. Cette organisation avait été prévue lors du passage du pasteur Curie, le 18 décembre. Ce sera sans doute lui, d'ailleurs, qui va devenir le premier pasteur de notre communauté. Mais Noël étant un dimanche, on a dû aller au marché arabe à Sétif et ne faire le service religieux que l'après-midi dans la salle d'une maison encore inoccupée, car il n'y a pas de temple. Quel froid !
Pour l'école, il a fallu faire de même. II y a deux classes et le régent prend l'une le matin et l'autre l'après-midi. II a bien fallu que la compagnie fasse faire quelques bancs et quelques tables. Quant au chauffage, heureusement qu'un brave soldat a procuré un petit poêle pour ne pas laisser les enfants se geler. La compagnie a fait des difficultés, paraît-il, car elle dit que ce matériel est à la charge de l'Etat et non à la sienne. Néanmoins, les choses semblent bien aller. Tout s'organise. La compagnie a demandé qu'un maire soit désigné pour s'occuper des choses qui intéressent l'ensemble des colons. Le choix s'est porté sur Henry-Frédérik Viande, qui a déjà exercé ces fonctions en Suisse, à Bussy.
Les colons décimés par la maladie. - La situation est ainsi favorable pour donner en Suisse une publicité et Henry Dunant organise une tournée de propagande et de recrutement dans le canton de Vaud. Du 28 mars au 11 avril 1854 il parcourt les divers districts du canton pour y recruter les futurs agents d'émigration de la compagnie. II doit agir avec doigté car les autorités cantonales veulent freiner le courant d'émigration alors que certaines communes veulent se débarrasser des familles pauvres. II trouve ainsi des agents à Nyon, Morges, Lausanne, Moudon, Lavaux, Payerne, Avenches D'Orbe, Yverdon et même hors du canton à Neuchâtel et Morat. II décide de retourner à Sétif et la compagnie lui confie la tenue provisoire de la comptabilité et certaines missions. La compagnie lui obtient le passage gratuit et il arrive à Sétif à la fin de mai 1854. II y restera plus de trois mois, jusqu'à mi-septembre. Son séjour est probablement écourté par la terrible épidémie de choléra et de typhoïde qui frappe la colonie suisse. Depuis le samedi 20 mai, il y a une succession d'orages et de pluies torrentielles qui gênent les transports, qui abîment les constructions, qui bloquent tous les travaux des champs. Même les entrepreneurs demandent de repousser les délais dans leurs chantiers d'Ain Messaoud et de Bouhira. Le génie a dû arrêter ses travaux.
Pendant son séjour Henry Dunant a reçu mission d'aller faire enregistrer au bureau de Constantine les hypothèques sur Aïn Arnat.
A partir de juillet la maladie commence à faire ses ravages. Chaque jour il y a des morts. On a commencé à transporter les malades à l'hôpital de Sétif. Mais bien vite cela s'avère difficile et une antenne médicale est installée au village. La chaleur s'est mise de la partie, éprouvante, dure à supporter dans ces vêtements mal adaptés à un tel climat. Un soleil de plomb, un vent brûlant venu du désert. On est en sueur et il suffit de se mettre à l'ombre d'un mur pour attraper un chaud et froid. Certains se laissent aller à étancher leur soif en buvant du vin ou de la bière ; d'autres ne prennent même plus la peine de se laver et restent dans une saleté repoussante. On distribue des conseils d'hygiène qui ont été publiés par le ministère de la Guerre. II paraît que les Arabes tombent comme des mouches. La maladie continue à faire des ravages. Malgré cela on célébrera la fête du 15 août à Sétif, salves d'artillerie, revue des troupes sur le champ de manœuvre, défilé devant le général et son état-major aux cris de " Vive l'Empereur ! ". Le soir il y aura un bal champêtre dans la promenade du duc d'Orléans. Au village, la petite garnison a défilé, mais il n'y a pas eu de bal car il y a trop de deuils. Certaines familles sont pratiquement décimées : 7 morts sur 11 chez les Sergy, 4 sur 7 chez les Delessert, 8 sur 14 chez les Favre, 10 sur 11 chez les Burnens...
Beaucoup se découragent, certains décident de rentrer en Suisse, d'autres se placent comme domestiques dans des fermes de la région, des enfants sont placés comme gardiens de troupeaux, d'autres sont envoyés à l'orphelinat de Dély Ibrahim car ils n'ont plus de parents ; des épouses vont travailler à Sétif comme couturières ou femmes de ménage. C'est une catastrophe.
Pour se justifier, la compagnie fait des rapports accablants sur les malheureux colons faisant tomber sur eux la responsabilité du fléau dont ils sont victimes. Elle omet de rapporter que la mort frappe partout et qu'à El Ouricia, par exemple, tous les travaux sont arrêtés car les ouvriers kabyles, frappés de terreur, ont fui et sont repartis vers leurs montagnes.
Henry Dunant a vanté les vertus d'un remède du pasteur Curie qui est venu se dévouer à A'in Arnat avant même le début de l'épidémie :
" Un litre de cognac très spiritueux, du camphre gros comme un œuf, deux fortes pincées de bourrache (avec fleurs), une forte pincée d'aigremoine une pincée de sauge et de camomille. Mêler ensemble, boucher, laisser infuser pendant quarante-huit heures à froid, passer au tamis, mettre dans une bouteille bien bouchée. On fait boire plein un verre de cabaret, une seule dose doit arrêter les nausées et remettre le malade à flot. "
Son succès a été tel que les autorités en ont ordonné l'instruction dans l'hôpital de la ville. Mais la mort avait fauché plus de 90 personnes !
Changement de politique, les colons savoisiens. - Devant la situation que ces tragiques circonstances imposaient, la compagnie reprit les lots abandonnés ou défaillants et créa un omnium, composé des principaux actionnaires, qui pouvait ainsi acquérir les différents lots non vendus. II suffisait de trouver des prête-noms auxquels, par précaution, on faisait signer une contre-lettre. C'est ainsi que pour Aïn Messaoud les 50 lots appartenaient à deux colons !
Henry Dunant repart pour l'Algérie le 1er mars 1855 en compagnie de son frère Daniel. Quelques amis genevois lui remettent alors la gestion d'un certain nombre de lots qu'ils possèdent (les Demole, Necker et d'Hauteville). La famille de Gingins La Sarraz a, elle aussi, acquis des lots : en 1854 elle en possédait déjà 10 sur 50 à Bouhira.
La mission de Dunant n'est pas simple car les autorités militaires viennent de découvrir que pour 1854 certains lots ont été affermés de 600 à 700 F, ce qui ôte aux fermiers toutes chances de réussir. Les propriétaires doivent alors reconnaître qu'ils ont exagéré et exonèrent leurs fermiers pour l'année écoulée. Par la suite les prix de location sont " ramenés " entre 280 et 300 F, ce qui reste encore très excessif.
Henry Dunant trouve ainsi une colonie en pleine crise. Sa première impression est déplorable. En quelques mois les Suisses se sont aliénés les indigènes avec lesquels ils sont en conflit pour la délimitation des zones de pâturage. Mais qui a mal délimité ces zones ?
Comme il l'écrit au comte Sautter de Beauregard, l'état moral de la population d'Aïn Arnat lui paraît ce qu'il y a de pire à Sétif : des gens découragés, parfois affamés, des familles décimées, un régent ivrogne (ce n'est plus M. Ducraux, qui est parti) que le pasteur doit chasser, un début de prostitution favorisée par la misère et la garnison toute proche, tout cela donne une image d'un village à la dérive.
Très attachée à établir à Sétif une colonisation suisse et protestante, la compagnie est bien obligée de se rendre à l'évidence : le recrutement ne donne plus de résultat en Suisse, où une campagne de presse se déchaîne contre elle. Elle décide alors :
1. De ne plus apparaître comme une compagnie de seuls capitaux suisses et elle fait entrer au conseil d'administration deux banquiers lyonnais avec lesquels ses intérêts sont déjà très liés (Crédit Lyonnais, Chemins de Fer, etc.).
2. De faire procéder à un recrutement intensif chez les Savoisiens (la Savoie n'appartient pas, alors à la France) et en Bourgogne. Le recrutement donnant de bons résultats, on pense d'abord installer ces nouveaux colons à El Ouricia, mais à leur arrivée on les dirige vers Mahouan. Dans ce village au peuplement catholique, un premier convoi arrive en octobre 1855 (embarquement à Marseille le 8 octobre). Ce sont ainsi 112 Savoisiens et quelques Français de la Côte-d'Or qui s'installent dans ce village. Un prêtre arrive : l'abbé Gatheron. L'église n'est pas encore construite et, chaque soir, les prières sont dites dans la salle d'une maison. Trois religieuses de la doctrine chrétienne viennent également s'occuper des familles, animent un centre de soins.
La compagnie étend les surfaces qu'elle occupe par les nouvelles concessions qui lui sont attribuées au fur et à mesure de la construction des villages. Même lorsque ceux-ci ne sont pas achevés - et c'est pourquoi elle les entame tous - elle adresse des demandes insistantes au ministre de la Guerre, au prince Napoléon (cousin de l'Empereur, président du Conseil supérieur de l'Algérie et des Colonies) au gouverneur général... Les villages ainsi entamés sont Somerah, Aïn Trick, Aïn Mahla, El Hassi et Aïn Mouss. Elle veut faire valoir les efforts considérables qu'elle consent. et la nécessité de recevoir ses terres pour se procurer des ressources indispensables. Et pourtant, on voit bien que nombre de lots sont, en fait, remis par la compagnie à des Arabes, en location. Ceux-là même qui les cultivaient, à leur manière bien sûr, devront acquitter leur location à la compagnie à un prix bien supérieur. L'Etat s'est ainsi privé de ressources que la compagnie, qui a pris ses lieu et place, en retire plus avantageusement. Dans ses demandes elle plaide désormais pour la grande propriété
" La compagnie rendrait un véritable service à l' Algérie si elle créait sur les 80 000 hectares qui nous sont promis de vastes fermes, y élevait des constructions importantes et ne constituant pas de petits propriétaires trop prompts à se décourager et d'ailleurs trop rares, Offrait sur ses terres un salaire assuré aux Européens qui ayant le désir d'émigrer, ne posséderaient pas les 3 000 F indispensables. " (Lettre de M.Sautter de Beauregard à S.E. le maréchal comte Vaillant, ministre de la Guerre - le 9 décembre 1854.)
Où en est donc l'engagement initial et essentiel de peuplement ? Oublie-t-elle que les 80 000 hectares dont elle parle n'auraient pu lui être concédés que si, à la fin de 1854, cinq villages avaient été entièrement construits et peuplés ?
Des différends opposent la Compagnie genevoise et le gouvernement français. - En août 1855, la compagnie émet une demande plus modeste de 8 000 hectares pour y appliquer le système des " grandes fermes " : ... Refus.
En 1856, demande de 46 000 hectares à charge d'organiser un service de caravanes entre Constantine et le Soudan : ... même échec.
En 1857, elle revient à la proposition du système de 1853. Elle propose, en plus de construire et peupler dix villages de quarante feux entre Sétif et Constantine et demande en rétribution 14275 hectares, soit près de 1 500 hectares par village au lieu des 800 de la concession de 1853.
... Nouveau refus.
Elle revient à la charge et menace de se retirer. De guerre lasse, le maréchal Randon propose, en restant dans les limites de la concession d'origine, d'accorder des facilités à la compagnie pour rétablir l'équilibre entre ses dépenses et ses recettes.
A Paris, au conseil présidé par le prince Napoléon, un rapport est fait pour démontrer à quel point les comptes de la compagnie sont faussés. Elle a, en effet, dans ses statuts, prévu d'attribuer :
- des actions financières (6000 de 500 F) dites de capital ;
- des actions de jouissance en même nombre que les précédentes ;
- des actions de jouissance de même nombre, mais seulement attribuées aux concessionnaires d'origine.
Comme il est prévu que les actions financières qui rapportent un intérêt de 5 % l'an seront remboursées par tirage au sort chaque année à 625 F, il reste évident que les huit concessionnaires initiaux entendent se réserver la majorité absolue pour la marche de la compagnie.
Ainsi donc les actionnaires fondateurs dont le capital aurait été ainsi intégralement remboursé resteraient toujours actionnaires et percevraient des dividendes sur une mise de fonds qui n'existerait plus ! Ainsi, la compagnie se prive délibérément de fonds propres indispensables à la marche de l'entreprise et aux investissements.
Pourtant, le 24 avril 1858, l'Empereur prend une décision par laquelle la compagnie est dispensée :
- de construire le dernier et dixième village ; - d'achever le peuplement des neuf villages qu'elle avait bâtis.
Elle avait édifié 450 maisons en mortier de terre (au lieu de 500 en maçonnerie). Elle y avait installé 130 familles (au lieu de 500). On lui accordait 12 340 hectares en la dispensant d'exécuter ses engagements (au lieu de 8 000 qui lui étaient promis à condition de les remplir).
Voici la compagnie libre vis-à-vis de l'Etat. Elle ne désespère pas et demande encore 7 000 hectares à acheter à 20 F l'hectare (soit dix fois moins que la valeur réelle) des deux azels de Guellal et du Hammam, formés en grande partie de prairies et de terres de premier choix.
Le gouverneur général, dans son rapport au prince Napoléon du 19 décembre 1858, déclare : " La Compagnie genevoise n'a ni bien bâti, ni bien peuplé, ni bien cultivé. On l'a traitée comme si elle avait fait tout cela de la manière la plus remarquable. On ne pourrait pousser la libéralité plus loin sans froisser à la fois les principes d'une bonne justice et les véritables intérêts du pays. "
La compagnie se console et décide de renoncer peu à peu aux cultures européennes, à faire cultiver par des métayers indigènes toutes les terres pour lesquelles elle pourra trouver des Arabes. Agissant ainsi elle estime suivre l'exemple des Anglais dans leurs colonies.
Tels furent les résultats de cette grande entreprise, la plus importante qui eût été conduite jusque-là et qui, de ce fait, a bénéficié d'une mansuétude particulière. Sa ruine, en effet, ou son échec auraient pu décourager les autres entreprises et les investissements de capitaux en Algérie. II est évident que la compagnie s'était trompée dans ses calculs par les exagérations du rendement de la terre. Elle se référait aux informations données par Pline qui assurait qu'on avait vu des souches de froment qui avaient 80 et même 120 chaumes provenus de la même semence, ce qui se rapproche de l'exemple merveilleux de ce blé envoyé à Néron et dont un seul grain avait fourni 340 tiges.., On en était certes fort loin !
Echec de la colonisation de peuplement. - Au cours de la période 1858 à 1956 (date de son " expropriation " au profit de la C.A.P. E..R (7), expropriation largement indemnisée). La compagnie mène une politique commerciale. En travaillant si âprement pour elle-même, sert-elle, en même temps, la collectivité ? Dans une faible mesure seulement. Ses intérêts particuliers se sont toujours trouvés en opposition avec l'intérêt général.
D'abord, elle décide de réaliser les créances hypothécaires qu'elle consenties aux petits colons et les menace d'une expropriation générale dont le résultat serait de récupérer 5 000 à 6 000 hectares et 300 maisons. C'était tuer la colonisation déjà si compromise. Elle inspire alors une pétition des colons qui supplient l'Empereur d'accepter les offres de la compagnie qui demande pour abandonner les poursuites, une concession de 20000 hectares dans la plaine du Hodna pour y créer une exploitation moutonnière. L'Etat, lassé des abandons déjà consentis, refuse.
Par suite des reprises sur ses débiteurs la compagnie fait alors passer son domaine de 12340 hectares en 1858 à 14518 hectares en 1861 Elle liquide matériel et cheptel et fait appel aux fermiers ou métayers. Ses revenus suivent alors une courbe ascendante.
Mais, dès 1862, le sous-préfet de Sétif écrit :
" Le vide européen s'est fait sur l'immense domaine de la Compagnie genevoise qui n'exploite plus par elle-même et ne constituera désormais qu'une caisse de recouvrement ouverte à Sétif pour le compte des actionnaires de Genève. "
En 1858, la compagnie avait dirigé vers l'Algérie, d'après ses statistiques, 2 956 émigrants. En 1930, ils n'étaient plus qu'une centaine. Par contre, les Arabes sont revenus à titre de locataires sur les terres de la compagnie qu'ils exploitaient auparavant comme locataires de l'Etat à des conditions bien plus avantageuses.
Si les revenus sont passés de 321920 F en 1870 à 13369000 F 1929, la population européenne est passée pendant le même temps de 428 à 120 et la population indigène de 2917 à 3700.
Non contente de recourir aux mesures expliquées plus haut, la compagnie use, pour agrandir encore son territoire et augmenter ses revenus, de procédés qu'elle prétend légaux mais qui n'en ont que la trompeuse apparence, De 1863 à 1916 se déroule la douloureuse " affaire des terrains de parcours " qui donne lieu à de retentissants procès qui firent peser un vrai malaise sur la région sétifienne. Devant la carence de l'Etat, des communes vont contre la compagnie, mais elles succombent bientôt.
Si la compagnie a failli dans la tâche essentielle pour laquelle elle a été constituée, elle a, par contre, comme entreprise agricole, réalisé une oeuvre économique pour laquelle il convient de reconnaître ses mérites. La formule qu'elle adopte principalement est celle du métayage aux 2/5. La compagnie n'offre que son capital-terre. Le métayer fournit son travail et le matériel d'exploitation. Le partage des produits se fait à raison de 40 % pour la compagnie et 60 % pour le métayer. Mais le mode d'exploitation est strictement réglementé par la compagnie et aucune initiative n'est laissée au métayer. Cela n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose car la compagnie a pu déterminer les modes de culture les plus appropriés au milieu et au sol.
Pour l'agriculture sétifienne elle aura été une excellente école. II faut signaler, ici, l'action réalisée par M. Gottlieb Ryf, directeur de la compagnie à Sétif, qui fut un véritable novateur en appliquant dès 1898 sur les hauts plateaux le " Dry Farming " qu'il avait découvert lors d'un voyage d'études aux Etats-Unis. Par ce système, la compagnie qui avait des rendements de 5 à 6 quintaux à l'hectare, atteignit 14 à 15 quintaux en 1918 (année exceptionnelle, il est vrai), mais la moyenne ressort à 9 quintaux pour le blé et à 10 quintaux pour l'orge.
Ces résultats économiques, s'ils sont satisfaisants, le sont d'abord pour la compagnie qui n'a aucun frais à engager. Par contre, le mode d'exploitation qu'elle impose à ses métayers leur occasionne des frais importants. Un vieux cultivateur disait un jour à M. Sautter de Beauregard, en visite à Sétif :
" Ce ne sont pas des vivants que vous avez devant vous, Monsieur le Président, ce sont des morts, car ils n'ont travaillé toute leur vie que pour la compagnie. "
Du point de vue de l'État français c'est une perte sèche car chaque année, même pendant la guerre de 1914-1918, les capitaux se déversent dans les caisses de Genève. II en fut de même pendant le dernier conflit mondial. La compagnie s'est du reste abstenue de participer à tous lés emprunts de Défense nationale. Rien n'a donc été réinvesti en Algérie et aucune contribution n'a été apportée au développement de ce pays.
Par cette enclave soustraite au peuplement national la compagnie a gêné considérablement le développement de la ville de Sétif. En 1882, le Gouverneur général Tirman, de passage à Sétif, reçoit les doléances de la population. II reconnaît que " Sétif est étouffé par la Compagnie genevoise et qu'il est urgent de donner de l'air à la ville ". De nombreux projets se succèdent: projet Panisse en 1883 projet Lagarde en 1890. Des vœux sont émis en 1901, renouvelés en 1903 par les délégations financières et le Conseil général. En 1922, sur proposition de M. Morinaud, député de Constantine, la question est élargie et il est demandé le rachat de tous les grands domaines. Mais aucune décision n'intervient.
On connaît la suite... Mais on peut rêver à ce qui aurait pu être, si ces immensités de la Compagnie genevoise (15000 hectares), de la Compagnie algérienne (100000 hectares) avaient pu être remises dans les mains de nouvelles familles françaises qui par leur enracinement auraient fait souche. Pour la seule Compagnie genevoise on aurait pu installer une centaine de familles !
Claude SCHURER
SOURCES
-
Archives personnelles et familiales.
- Archives d'Etat de Genève (archives de la Compagnie genevoise).
- " La Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif " - Centenaire
de l'Algérie - Par René Passeron, 1930.
- " Henry Dunant l'Algérien ", de Jacques Pous, Ed. Grounauer, Genève,
1979.
- " Résumé des documents relatifs à l'émigration dans les colonies suisses de
-Sétif en Algérie - Mai 1854 ", aimablement communiqué par la délégation de
L'Algérianiste à Perpignan (M. Brasier et Mme L. Sèbe).
- " Annales de la colonisation algérienne ", par Hippolyte Peut, Paris,
1856.
- " Le Courrier du dimanche ", journal du protestantisme en Afrique du
Nord, numéro du centenaire 1930
- Mémoires d'Isaac Morel, Bouhira, le 30 mars 1895.
- Service historique de l'Armée de terre, château de Vincennes. Service
historique de l'Armée de terre -
- Service du génie à Vincennes.
- Archives nationales.
NOTES
Autre article
La
Cie Genevoise était apparemment un frein a la colonisation, si j'en crois
les
dires du Préfet rapportes dans le livre "l'Arrachement" l'Algérie de
1830
a 1962, (Editions Giletta nice) je cite :
"
Il n'y a actuellement rien a faire pour la colonisation dans la commune de
Sétif.
Les centres qui y existent sont peu florissant, il est vrai, mais ne
peuvent
être agrandis que par l'expropriation des terres de la Cie Genevoise
qui
les enserrent et empêchent leur développement".
...........................
Cette
unité administrative (Sétif) présente un budget déficitaire 10.000
francs,
elle redoit 25.000 F a divers hôpitaux pour le traitement des
malades
indigents. Certains travaux n'ont pu être soldes faute de ressources.
La
Cie Genevoise, présidée par le Comte Sauter de Beauregard, s'était vu
attribuée
en 1853, par Napoléon III, 20.000 Ha de terres cultivables dans les
environs
de Sétif, elle peupla, les mauvaises terres, de colons en majorite
suisses
* et se réserva les bonnes en toute propriété. Mais dans ces
conditions
la plupart des colons abandonnèrent les concessions, seuls une
dizaine
continua.
En
1860, les colons se regroupèrent pour adresser un rapport sur les abus et
les
fraudes de la Cie, qui ne reçut que des avertissements et la Cie s
orientât
vers l'utilisation de métayers indigène. La Cie était devenu un
groupement
capitaliste, exploitant les terres qu'elle avait obtenu contre la
promesse
de colonisation et de peuplement.
Les
documents d'origines sont apparemment au CAOM, ou l'auteur les a
consulter
:
Setif
L8-26-28-46-64
Sociétés
L28 / 3L25 a 36 !
Dans
un autre registre, il faut savoir que l'Alfa, plante qui pousse seule
sur
les hauts plateaux et qui sert a faire les plus beaux beaux papiers,
avait
la « Sté Général des Alfas » , (principal actionnaire, Blachette)
comme
concessionnaire exclusif de 690.000 hectares depuis 1873.
Cette
Ste reversait en 1955 0,15 F/Tonne d'alfa ayant une valeur de 30.000
francs.
A son arrivé en Algerie Robert LACOSTE fera passer cette redevance
de
15 centimes a 1.000 francs par tonne.
*
Henry Dunant, père de la croix rouge, et colon suisse était installe du
cote
de Sétif.
Cordialement
Henri
(Riri) de Bab El Oued (Mizon)
Sur
les sites Anciens Combattant mes mel perso et de nombreux liens vers
villes
et villages d'Algérie et aussi liens vers "caom" d'Aix et demandes d
actes
en ligne à Nantes et certaines communes de France:
Mes
Sites web
http://combattantsafn.free.fr/ Anciens
combattants d'Algérie
http://membres.lycos.fr/aamafn Anciens
combattants d'AFN
http://nemoplongee.freezee.org/ plonger
à Cannes
http://www.gander06.com/ plonger
a Mandelieu
AUTRE ARTICLE
 Le
meunier Nouridine pose devant les meules de l'époque de Henry Dunant - 1859.
(Photo: Olivier Grivat)
Le
meunier Nouridine pose devant les meules de l'époque de Henry Dunant - 1859.
(Photo: Olivier Grivat)
L'Algérie est l'hôte d'honneur du Comptoir suisse à Lausanne qui ouvre ses portes vendredi. L'occasion d'évoquer l'époque où plus de cent familles vaudoises parmi les plus pauvres ont émigré à Sétif.
Ce contenu a été publié le 18 septembre 2008 - 07:31 18 septembre 2008 - 07:31
«L'air est pur ici, quoi qu'assez frais; à peu de chose près, il ressemble à
celui de la Suisse en hiver», écrivent Charles Vulliamy et François Burnens à
leurs proches restés dans le canton de Vaud. On est en 1855. Ces agriculteurs
qui vivaient en Suisse «dans une position très gênée et très pénible», selon le
livre de commune, ont émigré quelques années auparavant à Sétif, au cœur de
l'Algérie.
Les autorités leur ont versé un subside communal de 1875 francs par famille pour
emmener leurs nombreuses bouches à nourrir: sept enfants pour François Burnens,
six pour Charles Vulliamy, cinq pour Georges Vulliamy. Ils ont pris souche dans
le village d'Ain-Arnat dans la banlieue proche de Sétif.
Sétif, une exception suisse
Près de 150 ans plus tard, on peut repérer encore quelques maisons datant de
l'époque des colons suisses. Construit par le Génie français, un temple
protestant désaffecté subsiste en terres musulmanes. Sur son clocher trônent
deux beaux nids de cigognes. Heureux présage?
La Suisse n'a que rarement été associée au fait colonial. Sétif est une
exception notoire. A l'origine, huit personnalités suisses, dont le comte
Sautter de Beauregard de la banque Lullin & Sautter, Paul-Elisée Lullin,
Jacques-Marie Mirabaud, le Baron de Gingins-La Sarraz et l'ancien conseiller
d'Etat genevois Jean-Antoine Fazy, créent une compagnie coloniale en Algérie
avec la bénédiction de l'empereur Napoléon III.
Le décret impérial leur concède 20'000 hectares avec la possibilité d'implanter
dix villages aux portes de la Kabylie. Le recrutement des colons s'effectue par
un battage efficace dans le canton de Vaud. Paris leur accorde le passage
maritime gratuit pendant 10 ans. Le coût maximum de chaque maison est fixé à
2'500 francs. Les colons sont tenus de déposer 2000 francs pour l'achat des
bestiaux et instruments nécessaires à la mise en culture de 20 hectares remis à
chaque famille.
Les appels d'Henry Dunant
Tout près de là se dressent les ruines romaines de Djemila, classées au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Un nom qui sera repris pour sa société par le
Genevois Henry Dunant, arrivé à Sétif, à l'âge de 25 ans, comme employé de la
colonie suisse.
Le père de la Croix-Rouge est l'auteur d'annonces parues dans le Journal de
Genève pour recruter des colons, promettant une main d'œuvre arabe bon
marché. Quelques années plus tard, il va construire des moulins à blé et créer
la S.A. des Moulins de Mons-Djemila, près de la cité romaine.
Aujourd'hui, ses moulins sont encore opérationnels et l'on retrouve, entassées
dans un coin, les meules d'époque fabriquées à Corbeil (France). Une pierre avec
la date de 1859 prouve l'authenticité de ces moulins qui vont conduire «Dunant
l'Africain» à la faillite.
La même année, il prendra son bâton de pèlerin pour contacter l'empereur
Napoléon à Solferino, en Italie. La vision du champ de bataille donnera au futur
Prix Nobel de la Paix l'idée de fonder la Croix-Rouge en 1862.
Fièvres, typhus et choléra
A cette date, les colons suisses de Sétif se comptent par centaines. Mais la
désillusion guette. Dix colons rédigent une lettre collective à Monsieur le
Baron de Gingins: «Il nous est absolument impossible de payer le prix des
fermes. Vous nous avez promis de belles prairies et que nous trouverions du blé
semé en quantité. Nous demandons d'être logés comme des Suisses non comme des
Arabes. Nous ne pouvons pas tenir les bêtes dans nos logements comme eux. Nous
demandons le remboursement de notre argent dans les plus brefs délais».
Les malheurs vont s'abattre sur la colonie. Les orages dévastent maisons et
cultures. Une épidémie de choléra frappe en juillet 1854. A fin 1854, on déplore
100 morts sur 388 habitants.
Le général commandant la subdivision de Sétif n'est pas tendre avec les colons:
«C'est une race de mœurs douces sinon d'une innocence patriarcale, mais peu
énergiques, routiniers, entêtés de sa mauvaise hygiène, sans beaucoup d'ordre ni
de propreté, et d'une sobriété qui laisse à désirer. Certaines maisons ont
renfermé jusqu'à trois familles. C'est à cet entassement qu'on attribue une
grande partie des maladies».
Les raisons d'un échec
L'historien Claude Lützelschwab trouve une autre explication. Dans sa thèse
parue en 2007, ce professeur d'histoire économique et sociale de l'Université de
Neuchâtel invoque «la coexistence forcée des colons et de la population indigène
dans l'agriculture (...). La seule issue possible pour les Européens, dans ces
régions de hautes plaines, fut l'évolution vers l'agriculture capitaliste qui
s'opéra dans les décennies 1890-1900».
En 1958, avant l'indépendance de l'Algérie, la Compagnie genevoise des colonies
suisses de Sétif fit l'objet d'une expropriation du gouvernement français.
Rachetées aux derniers colons, les terres furent redistribuées aux indigènes,
tirant le voile sur un épisode rarissime de colonisation suisse
PLAINTE DES COLONS FRANCAIS adressée à Napoléon 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Insurrection à SOUK AHRAS
C’est dans cette journée que Pierre Ccatelin et André vincent seront victimes
Le lundi 23 janvier 1871,
vers six heures du soir, un européen d'origine espagnol Raymond SERRA,
travaillant sur un chantier construisant une route, vint prévenir les autorités
que les Spahis d'Aïn Guettar (l'actuel Gambetta), situé à environ 15 kilomètres
au Sud Est de Souk-Ahras, ont tué le brigadier français
LERAZEVET, au lieu dit Roumilla, qu'ils ont ouvert le feu sur
lui-même et ses camarades du chantier, SIBY fils, CLIET Henri, FLEURY et
un caporal du Génie qui dirigeait les travaux ainsi que FLAMENCOURT qui
chassait tout à côté. Le groupe des assaillis s'étant dispersé, il ignorait le
sort de chacun.
Aussitôt on fait appel au peloton des francs-tireurs et à quelques cavaliers, en
tout trente cinq hommes de la milice. A huit heures du soir, le Maire en tête,
ils partent à la recherche de leurs concitoyens. Arrivés au moulin Lavigne,
limite du territoire civil, à neuf heures et demie, ils retrouvent l'un des
ouvriers, CLIET Henri sain et sauf. Les recherches sont arrêtées à cause
de l'obscurité totale. Mais on envoie un émissaire à l'administration militaire
pour avoir des nouvelles des autres ouvriers et on demande un renfort de vingt
cinq à trente mobiles, commandés par un officier, afin de continuer les
recherches dans le territoire militaire, ramener les ouvriers morts ou vifs,
dégager le cadre français de la Smala cerné dans le bordj d'Aïn-Guettar.
|
La halle aux grains |
A onze heures du soir l'administrateur militaire répondait au maire annonçant que FLAMENCOURT et SIBY étaient rentrés mais qu'il n'avait pas de nouvelles de FLEURY ni du caporal du Génie ; il pense qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer un détachement et ajoute que le général et le Sous-Préfet de Bône conseillent la vigilance et la plus grande prudence.Le détachement de miliciens faisant demi-tour arrive à Souk-Ahras à quatre heures du matin où il trouve la milice sur pied.. |
On apprend que FLEURY et le caporal du génie avaient été recueillis par le fils du cheikh Mohamed Seghir et qu'ils étaient rentrés à Souk-Ahras.
L'administrateur militaire se référant aux chefs indigènes ne pense pas qu'il y
ait une insurrection. Néanmoins, il avise les Européens isolés d'avoir à rentrer
en ville et invite le maire à faire de même à l'égard de ceux qui se trouvent en
territoire civil et il met au point un plan de défense de la ville.
De son côté, le maire fait doubler les postes de la milice, demande des renforts
à Bône pour protéger les fermes et renforcer la milice à Souk-Ahras.
Le mercredi 25 janvier, un poteau télégraphique est coupé à dix sept kilomètres
de Souk-Ahras, des coups de feu sont entendus dans la direction d'Aïn Guettar,
des rumeurs colportées par des indigènes inquiètent la population. Enfin le 26
janvier, l'envoi de troupes de Bône est promis.
A onze heures du matin, une panique générale se produit sur le marché. Une foule
tumultueuse afflue vers la ville et déborde sur la rue de Bône , les habitants
ferment portes et volets, l'anxiété est générale, la milice se réunit
spontanément.
|
Apparaît alors un goum commandé par le chef du Bureau arabe, le capitaine
Havas duTailly. Il parcourt au pas les rues transversales dans
l'intérieur de la ville. |
|
L'administrateur militaire donne un escorte composée de trois spahis et d'un
cavalier du caïd des Hanencha. M. DEYRON, retenu par le service de la
milice, en sa qualité de lieutenant du peloton des francs-tireurs, c'est M.
CHOISELAT, géomètre du cadastre qui s'offre spontanément pour aller au
moulin. Il part en cabriolet avec Mohamed bon Tala, Indigène de service.
A trois heures et demie de l'après midi, M. LAVIGNE fils, également
minotier, n'avait pu atteindre son usine et rentrait à Souk-Ahras annonçant que
l'ennemi occupait la vallée de la Medjerdah et commençait le pillage. En même
temps on apprenait que M. CHOISELAT et les deux charretiers ROMIN et
BIOLET
Célestin avaient été massacrés, que FABRER Guillaume avec trois
autres personnes se trouvant au moulin Deyron avaient pu fuir.
A quatre heures, on entendit une fusillade hors de la ville, l'attaque
commençait. Les francs-tireurs s'étaient portés au pas de course sur le marché
et le reste de la milice aux différents postes assignés par avance par le plan
de défense.
La partie Est, dite basse ville, commandée par le bordj, le cimetière et les
crêtes avancées, étaient gardés par les mobiles. La milice occupait le front Sud
du marché et le front Sud-Ouest, sur une ligne partant du Bureau arabe et
aboutissant au château d'eau. Les escarpements du ravin de l'Oued-Zerga
protégeaient suffisamment l'autre face. Néanmoins des barricades y fermaient
l'entrée des rues. Un obusier était placé sur le mamelon du Bureau arabe, un
autre au château d'eau.
Le goum et les spahis étaient massés autour du Bureau arabe, un poste de mobiles
était sur la place, la gendarmerie et la douane étaient sur le qui vive. Les
femmes, les enfants et les invalides s'étaient réfugiés au bordj, (ces
dispositions furent observées jusqu'au dégagement de la ville à l'arrivée de la
colonne de secours, le 30 janvier).
Le sous-lieutenant de spahis BOUNOMON, sorti en reconnaissance dans la
direction des mamelons dominant le marché, revint à toute bride annonçant que
l'ennemi se présentait en très grand nombre sur le revers.
Un feu soutenu força l'ennemi à se replier derrière un second mamelon. Les
francs-tireurs alors s'élancent de nouveau et s'emparent du mamelon de gauche.
Ils parviennent à faire cesser le feu des assaillants et disperser un groupe
d'environ vingt spahis déserteurs qui s'apprêtaient à charger. Cet engagement
dura
environ deux heures.
Le soir chacun reprend son poste et veille toute la nuit, on élève des
barricades et on crénelle les maisons bordant la face du marché. Le vendredi 27
janvier, vers huit heures du matin, on aperçoit les spahis déser-
teurs emmenant les troupeaux pris dans les fermes. Des colonnes d'épaisse fumée
s'élèvent en diverses directions, quelques obus dissipent un groupe de
cavaliers, les insurgés engagent le combat sur les mamelons tandis qu'ils font
défiler leurs prises.
Le samedi 28 janvier, goum, spahis et peloton de douane, commandés par
l'administrateur militaire et par le chef du Bureau arabe, poussent une
reconnaissance sur la route de Bône, afin de récupérer les morts. Ils sont
accueillis par un feu nourri des insurgés et ne peuvent que recueillir le
cadavre du jeune
VINCENT.PIERRE
Dans la matinée de nombreuses escarmouches avec feu nourri sur le front gardé
par les francs-tireurs ; au milieu du jour, le pluie ralentit les velléités des
assaillants.
Le dimanche 29 janvier, une nouvelle reconnaissance commandée par les mêmes
officiers et appuyée par trente mobiles, pousse jusqu'à la ferme Franco,
située sur la route de Bône, au grand tournant après la ferme Cordina à
deux kilomètres cinq cents de la ville. Elle recueille les cadavres des deux
autres frères André
et Catelin VINCENT
et se replie devant les insurgés, la retraite est protégée par les mobiles
déployés en tirailleurs.
L'administrateur informe que l'ennemi se propose de tenter un suprême effort sur la ville et, s'il ne réussit pas, de se retirer en Tunisie, avec son butin. Le lundi 30 janvier, les groupes observés dans la campagne sont moins nombreux et moins serrés. Les burnous rouges ont disparu, ils étaient à Aïn-Seynour. Les rebelles transportent leur butin, bestiaux et grains provenant des fermes pillées et incendiées. Au moment où, abusée par des renseignements de source indigène, on disait Barral et Duvivier retranchés et barri-cadés, la première colonne, partie de Bône arrive vers quatre heures du soir à Souk-Ahras.
Cette colonne partie de Bône le 26 janvier, sous le commandement du général POUGET, après avoir campé le 28 au soir à Aïn-Tahamimine entre en contact avec les insurgés, le 30 janvier au passage du ravin d'Aïn-Seynour, sur un front de bataille de six cents mètres, elle les met en déroute, leur causant des pertes sérieuses.
Les jours suivants des reconnaissances sont envoyées dans différentes directions afin de visiter les fermes. Une colonne se dirige vers Aïn-Guettar, elle en revient le 14 février, ramenant de nombreux prisonniers dont les principaux meneurs de cette insurrection : cheikh Salah bon Dahmani, cheikh Kaled bon Dahmani, caïd Ahmed bon Dahmani, caïd Ahmed Salah et son fils, cheikh Salah bon Ali Dridir.
Témoignages
Jean-Baptiste SUERY,
exploitant agricole associé avec un notable dans une région non encore contrôlée
par l'armée. Sentant le danger, il réussit à se cacher dans un four qui est
inachevé, qui se trouve non loin de son exploitation. Il s'introduit dans le
four, il mure l'entrée de l'intérieur en la maçonnant lui-même, laissant une
petite ouverture dérobée pour l'aération. Son associé lui fait passer quelque
nourriture par une trappe bloquée à l'intérieur par une grosse pierre. Les
rebelles se doutant qu'il était enfermé, essaient de démolir le four, mais un
éboulement de terre les décourage et ils abandonnent leur sinistre projet.
Jean-Baptiste SUERY est resté ainsi tapi pendant trois jours et demi, il
n'est sorti de son trou que lors du passage la colonne allant de Souk-Ahras à
Aïn-Guettar.
Le meunier VALENTIN a été cerné le 27 janvier, dans le moulin Saïd.
Secondé par son fils Raymond et son khammès Férath Chérif, ils repoussent
les rebelles pendant plus d'une heure, se défendant courageu-sement, tuant deux
assaillants, en blessant plusieurs autres. Sur le point de succomber devant leur
nombre, la porte d'entrée ayant été incendiée, VALENTIN et Raymond se
réfugient dans le puits de la turbine, fermant la trappe sur eux. Au bout de
deux heures, aidé par VALENTIN qui lui faisait échelle de son corps,
Raymond est parvenu à s'échapper par le canal d'amenée d'eau. VALENTIN
resté seul n'a pu atteindre l'orifice. Les Arabes voulant le noyer, ont
fermé le canal de décharge. A force d'énergie,
VALENTIN réussit à se maintenir sur l'eau, le puits s'étant rempli, il a
pu gagner l'ouverture du canal en s'y cramponnant. Immergé jusqu'aux épaules,
luttant contre le courant, il se résigne à attendre la nuit, dans cette
position. Vers six heures du soir, protégé par l'obscurité, il s'échappe, mais
ayant été aperçu à quelques pas du moulin, il essuie une fusillade qui ne
l'atteint pas. Glacé, exténué de fatigue et d'émotions, il se détourne du
chemin, traverse les champs afin d'échapper à ses poursuivants. Ce n'est qu'au
bout de trois heures qu'il réussit à rejoindre Souk-Ahras.
Par ailleurs, on se rappelle les circonstances dans lesquelles les voituriers ROMIN et BIOLET ainsi que le géomètre CHOISELAT se sont rendus au moulin Deyron, le 26 janvier.
Les charrettes escortées, arrivent au moulin vers trois heures, au moment où le cher meunier FABER Guillaume se dispose à partir à Souk-Ahras. Rassuré par la présence de CHOISELAT et de l'escorte, il effectue le chargement des farines.Deux spahis sont préposés à la garde du moulin, CHOISELAT repart en cabriolet, seul avec Mohamed bon Salah, les charrettes se remettent en route vers quatre heures, un quart d'heure plus tard, FABRER les suit, accompagné de son garçon meunier, le fils de ce dernier et d'un maçon. Arrivés en haut d'une côte, ils découvrent les charrettes abandonnées sur la route sans attelage, les cadavres de ROMIN et de BIOLET gisent sur la chaussée. Par ailleurs, M. CHOISELAT avait été assassiné non loin de la ville.
Plus tard les quatre cavaliers de l'escorte rentrent à Souk-Ahras, disant qu'ils
ont échangé des coups de feu avec les insurgés en grand nombre, le fils de M.
CHOISELAT revient également indemne, leurs burnous portant des traces de
balles.
FABRER, de son côté avec ses trois compagnons, cachés dans un ponceau,
aperçoivent une tente isolée et deux Arabes armés qui leur crient de s'éloigner,
le garçon meunier, son fils et le maçon se conforment à l'injonction, continuent
leur chemin vers Souk-Ahras qu'ils atteignent le jour même. FABRER,
connaissant
les deux Arabes, leur faisant confiance se dirige vers eux ; il est accueilli
par un coup de feu qui l'atteint dans la région des reins, il tombe dans une
mare de sang. On lui enlève son fusil, sa carnassière, ses bottes, à coup de
bâton les femmes le frappent le laissant pour mort. L'un des Arabes voulant
l'achever, l'autre lui dit :"laisse-le,
il est bien mort, ménageons notre poudre".
Pourtant bien que sérieusement blessé, il réussit à s'enfuir dans les
broussailles et se blottit dans l'endroit le plus touffu. Vers le milieu de la
nuit, il tente un dernier effort, gagne la ferme Deyron, tente d'escalader la
meule de fourrage pour s'y réchauffer. N'y arrivant pas il gagne une porcherie.
A la pointe du jour, un nouveau danger le contraint à déguerpir. Il entend les
Arabes qui enfoncent la porte de la chambre de Célestin BIOLLEY, tué la
veille. Il reconnaît le berger de la ferme et sa femme qui pillent la demeure.
Il se décide à fuir quand il entend le berger l'ap-
peler , moins confiant que la veille, il ne ralentit pas sa course et grâce à
l'obscurité réussit à se réfugier dans les broussailles. Après avoir récupéré un
peu de forces, il reprend sa marche et à proximité d'un douar, il entend un
Arabe reprochant à d'autres le pillage du moulin Deyron. Dans son indignation,
il les injuriait. FABRER comprenant parfaitement l'arabe, prenant des
risques, s'avance vers lui.
Lakdar bon Amor,
tel est son nom, le couvre immédiatement d'un burnous et l'assure de son
dévouement, il le cache dans une grotte où il lui fait passer toute la nuit.
|
|
|
|
Le lendemain, 28 janvier, Lakdar lui apporte des aliments auxquels il ne peut toucher, de la paille pour adoucir sa couche. Il est visiblement inquiet sur le sort de son hôte, il hésite entre la crainte de le laisser sans soins et celle de l'exposer en précipitant son départ pour Souk-Ahras. En ce qui le concerne, il est également inquiet, car si les insurgés apprennent qu'il a recueilli un Français, sa vie et celle des siens sont en en danger. Pourtant l'état de FABRER ne permettait plus d'attendre. A la nuit, un homme conduisant un mulet se présente à la grotte. Il est le cousin de Lakdar et invite FABRER à se confier à lui. Après l'avoir hissé sur le mulet, le guide monte derrière lui afin de le soutenir sur le berda. Puis escortés par Lakdar et deux autres cavaliers armés, ils prennent la direction de Souk-Ahras. "Si Souk-Ahras n'est pas aux mains des spahis rebelles, je répond de t'y conduire, dit Lakdar. Ces hommes que tu vois et moi nous mourrons pour te défendre. Mais si Souk-Ahras est aux mains des rebelles, je ne réponds pas de sauver, tu es trop faible pour aller plus loin".
Le groupe se met en marche. A une certaine distance un des cavaliers donne l'alerte. Il faut revenir en arrière et changer de direction. Enfin la petite troupe approche de la ville par le côté du marché. Sur le conseil de Lakdar, FABRER appelle pour se faire reconnaître, son escorte lui dit adieu et s'éloigne. Recueilli d'abord par le poste de miliciens, FABRER est aussitôt transféré à l'infirmerie.
Lakdar,
dont les anciens Souk-Ahrassiens ont conservé le souvenir, jouissait du respect
et de la considé- ration générale tant auprès des Français que des musulmans.
Son action d'éclat lui valut
une médaille d'honneur et le titre de "Caporal".
Il était aussi fier de l'un que de l'autre. Au douar, on l'appelait "Caporal"
tout court et, loin dans la région, on le connaissait sous cette dénomination.
Jamais il n'abandonna son douar d'origine où il avait recueilli FABRER. Il est
décédé
vers 1892.
Maurice VILLARD
Crédit revue Ensemble N°234 10/2002
Que sont ils devenus après cette terrible journée
***Pour Catelin vincent et Claudine buffet( mes arrières g parents);Catelin est enterré dans le cimetière de SOUK AHRAS ,Claudine Buffet va élever ses enfants Catherine née à
Voglans le 20/11/1857-- ;Jeannette née à el ouricia 07/11/1859-- ;joseph né 06/02/1862 à El Ouricia( mon g père) -- Marie Joséphine née le 10/03/1968 à Souk Ahras --Françoise née le 26/08/1870 à Souk Ahras Claudine BUFFET, va faire une demande de terre à AIN SEYNOUR et se remarier avec JEAN Bedascuru ;ils auront trois enfants --Marie louise 17/08/1874
–louis Rémy 1880 27/08/1877—jules 1880 ;elle décédera à Souk AHRAS le 14/04/1944 après élevée les enfants des deux couples
***Pour André Vincent et Beatris Dupuis-- André peut être enterré dans le cimetière de Souk Ahras ---;(leur fils Catelin né le 0 4/06/1861 et la mère Béatris ……nous ne savons pas)
***Pour joseph Vincent et Noëlle Buffet ils ont perdu leur fils Pierre dans cette tragédie né le à voglans le 28/04/1861 ( leur fille Claudine né le 28/04/186le nous ne savons pas) joseph se remariera à Voglans avec Françoise Burdet 1843-1911 le 31 janvier 1872
Noëlle buffet serait décédée à Sétif le 30/09/1863…
après cet épisode tragique la famille du défunt Catelin et de Claudine BUFFET se retrouverons dans le village d 'Ain Seynour village d 'altitude et de neige en hiver ;ou retrouvera des familles issues de Savoie et de haute Savoie RAUCAZ,BOULET,MILLET BURGEAT LEBRUN,ROUGET SIBUET DALIX-- avec comme principale activité vigne l' élevage bovins et ovins ,foin tout cela jusqu'a 1962
henri vincent
,